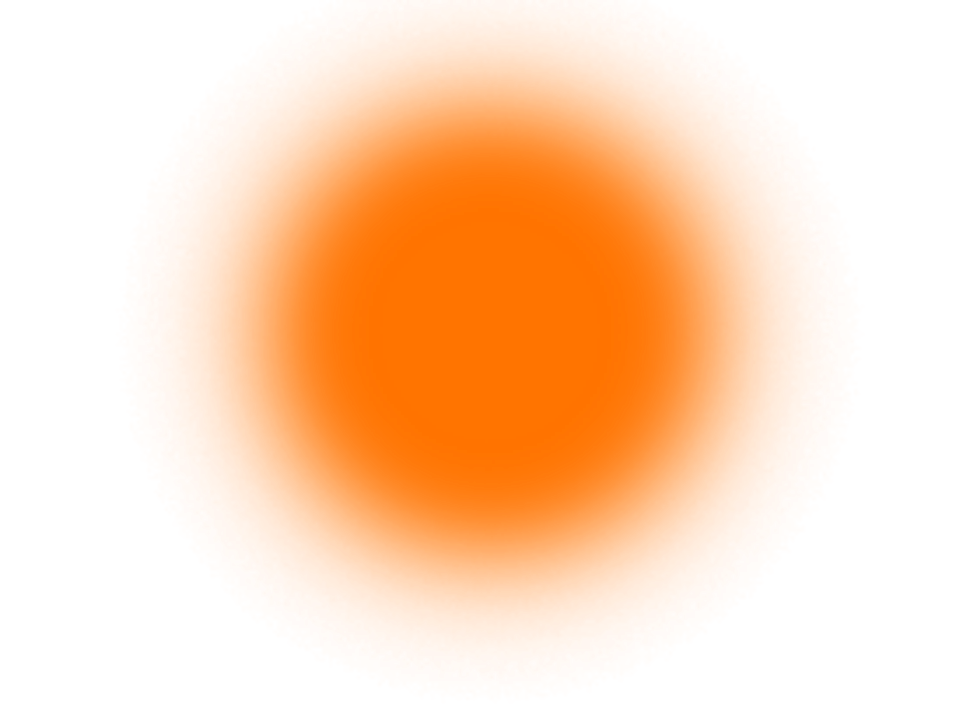France, 2025.
Ce qui continuait à me surprendre, deux ans après, c’était la manière radicale avec laquelle la pandémie était sortie de nos vies. Sa disparition brutale, stupéfiante, avait imprimé des marques profondes dans le tissu du quotidien, avec la même violence, la même imprévisibilité que son arrivée, cinq ans plus tôt. Un coup de chance d’ampleur planétaire, quand on y repense. Alors que l’Occident parvenait péniblement, fin 2021, à vacciner la moitié de sa population en courant après un seuil d’immunité collective qui se dérobait mois après mois et au détriment, une nouvelle fois, du reste de l’humanité, l’émergence successive des variants Epsilon (Argentine, janvier 2022) et Sigma (Kazakhstan, avril 2022), partiellement résistants à la première génération de vaccins, avait foutu en l’air les espoirs de rétablissement collectif suscités par la première année de vaccination et la mise en place du pass sanitaire, l’été précédent.
On n’allait pas refaire la même erreur. Il fallait tout reprendre à zéro. Penser autrement. Vivre avec le virus du mieux possible en attendant la prochaine génération de vaccin, qui n’allait pas débarquer tout de suite. À l’époque, personne ne pouvait deviner qu’à peine six mois plus tard, le variant Omega (Côte d’Ivoire, décembre 2022), extrêmement contagieux mais beaucoup moins agressif que ses prédécesseurs, remplacerait progressivement tous les autres et mettrait fin naturellement à la première pandémie du 21e siècle à l’été 2023, à la stupéfaction générale. Mais à l’automne 2022, c’était la panique : la contamination progressait, le taux de létalité flirtait désormais avec les 1,5 %.
Il fallait agir.
Rapidement, efficacement, sans fléchir.
Repenser intégralement l’ordre social, le rapport à l’espace public et aux flux de personnes, le mode de gouvernance de crise. Fluidifier, optimiser, anticiper. Pour reprendre ad nauseam la devise néolibérale, il fallait s’adapter. La ministre de l’Intérieur déterra un rapport, publié en juin 2021 par trois sénateurs, qui proposait des solutions clé en main pour « retrouver nos libertés « physiques » plus vite, ou même ne jamais les abandonner, et avoir des pandémies sans confinement – et ceci, même si aucun vaccin ou traitement n’est disponible. » Bingo.
À la faveur d’une nouvelle extension de l’état d’urgence sanitaire pour six mois, la quasi-intégralité des systèmes de contrôle imaginés par les élus fut rapidement déployée dans les centres urbains pour faire la chasse aux infectés. Au niveau matériel, d’abord. Fort d’une augmentation de budget de 900 millions d’euros et inspiré par ce qui se faisait déjà en Chine, le ministère de l’Intérieur décida d’investir dans des essaims de drones de surveillance semi-autonomes, équipés de caméras thermiques et capables de projeter, au choix, un liquide virucide, ou un faisceau ultrasonore incapacitant. Après les expériences menées en 2020 dans les aéroports parisiens et la station de métro de Châtelet-Les Halles, les 1 200 caméras de vidéosurveillance de Paris embarquèrent à leur tour des algorithmes de reconnaissance faciale.
Le mobilier urbain de la ville « intelligente », que la 5G transformait déjà progressivement en un maillage étroit de capteurs censés optimiser la gestion énergétique, fut reprogrammé pour la traque des infectés, asymptomatiques ou non, avec l’aide active des opérateurs téléphoniques – la coopération entre Orange et l’Inserm, début 2020, pour modéliser les flux de population consécutifs au confinement, était encore dans les mémoires. Chaque feu tricolore, arrêt de bus, taxi autonome, vélo, trottinette ou banc public devint une balise, interrogeant minutieusement chaque téléphone portable, chaque bracelet connecté (sur conseil des sénateurs, ceux-ci furent progressivement rendus obligatoires) pour connaître le statut épidémiologique de son propriétaire – vert, orange ou rouge. La géolocalisation devint constante, sa précision devint rapidement inférieure au mètre.
Dans les transports publics, puis dans les cafés, restaurants, immeubles de bureaux et immeubles résidentiels qui pouvaient se les payer, des portiques intelligents (fournis par le spécialiste en la matière Thales) scrutaient désormais chaque entrant et son téléphone portable simultanément avant d’ouvrir leurs portes. La nouvelle génération de vêtements connectés (wearables), capables de prévenir leur propriétaire en cas de proximité avec un infecté, fournissait également aux autorités des informations sur les variables de santé de chaque individu, en temps réel. Chaque passant devint un auxiliaire involontaire de la sécurité sanitaire, un capteur mobile placé à disposition de l’ordre public. L’analyse de données au service de la sécurité : la smart city se fondait définitivement dans la safe city.
Si l’urbanisme des villes changea légèrement d’apparence entre 2022 et 2023, la véritable lame de fond technologique fut invisible au citoyen lambda. Au paroxysme de la panique, toutes les digues législatives régulant la collecte, le stockage et l’utilisation de données sautèrent. L’impératif sanitaire emporta la Cnil en une bourrasque. Selon les recommandations exactes des sénateurs et d’un rapport de l’Académie des technologies de mai 2021, qui reprenaient tous les deux le modèle de la plateforme de santé Health Data Hub fondée en juillet 2019, le ministère de la Santé créa un organisme central d’analyse de données en temps réel, le Crisis Data Hub. L’infrastructure était fournie par Microsoft, l’hébergement cloud des données par Amazon Web Services. Ses mots d’ordre : interopérabilité et décentralisation. L’oracle des sénateurs se réalisait. Pour contrôler l’épidémie, on allait « croiser trois types de données : données d’identification, données médicales, et données de localisation ».
Les géants de l’Internet mobile furent enrôlés dans la collecte, sans qu’on ait besoin de le leur demander deux fois, encore moins de les y obliger, comme l’avaient initialement prévu les sénateurs. Google et Apple ouvrirent grand leurs systèmes d’exploitation mobile Android et iOS. Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Waze, Doctolib, Amazon, Tinder et tous les autres fournirent prestement à l’État un accès backdoor à leurs applis, qui leur ouvrit en contrepartie l’accès aux analyses fournies par sa nouvelle plateforme. Gagnant-gagnant. Le centre de contrôle, d’inspiration cybernétique, fut rapidement branché aux bases de données judiciaires (TAJ, TES, AccReD, etc…) et sanitaires, créées entre 2020 et 2021 – Sidep, Contact Covid et Vaccin Covid –, puis aux bases de données bancaires, à l’Assurance maladie et à FranceConnect. Palantir, NSO et les autres spécialistes de l’analyse prédictive big data, habitués à travailler avec les forces de l’ordre et autres agences de renseignement, vinrent généreusement apporter leur contribution au grand œuvre.
Le méga-fichier des méga-fichiers.
Ainsi assemblée, la collection de données permettait d’avoir une vue d’ensemble de la France numérique et de ses habitants. Un buffet à volonté d’informations en temps réel, océan de variables et d’identifiants uniques. Une nouvelle carte du territoire, illisible aux yeux humains. Le plus dur était fait. Au croisement des flux, l’assemblage d’algorithmes chargé d’analyser la situation pour concevoir des scénarios sanitaires en temps réel fut baptisé Système automatisé de freinage de l’épidémie – SAFE.
Il fut placé sous la houlette du ministère de l’Intérieur et développé par l’Inria, avec le concours technique des habituels géants du numérique et d’IBM. Contrairement aux traditionnelles architectures en silo, SAFE était en fait un gigantesque assemblage décentralisé de réseaux de neurones, chacun bien au chaud dans ses serveurs, fonctionnant de concert via l’interface de programmation du Crisis data Hub. Chaque entreprise sélectionnée par le ministère apportait sa pierre à l’édifice et fournissait au système une nouvelle capacité.
Rien de plus simple : la plupart étaient déjà opérationnelles dans différents domaines industriels, et les entreprises sélectionnées avaient déjà toutes repositionné leurs systèmes prédictifs pour se positionner sur le marché émergent de la gestion sanitaire. Le véritable exploit technique fut de les faire fonctionner ensemble (à ce titre, la plateforme 3DS de Dassault Systèmes fut d’une aide précieuse). La start-up Datakalab fournit la reconnaissance faciale et l’identification des émotions individuelles, comme elle l’avait fait à Nice. Pour l’analyse des réseaux sociaux, on piocha chez Causality Link.
Thales assura l’optimisation des flux piétons et la gestion des transports en commun. Facebook mit à disposition son architecture de systèmes d’alerte, le Safety Check, et les ressources de sa plateforme de prévision épidémique Data For Good. Chaque nouvelle fonction augmentait exponentiellement la puissance d’analyse du système. Semaine après semaine, itération après itération, SAFE gagnait en omniscience et en capacité prévisionnelle.
Alimenté par de gigantesques fleuves d’informations en provenance de toujours plus de bases de données, sans cesse en train de fluidifier la relation entre ses différents composants, SAFE fut bientôt capable de générer un jumeau numérique, non seulement de la ville mais de chacun de ses habitants. Sa puissance de calcul lui permettait de simuler des infinités de scénarios. Quelques semaines plus tard, en février 2023, SAFE parvenait successivement à prédire l’apparition de clusters à Strasbourg, Amiens et Grenoble avec cinq jours d’avance. Son degré de précision quant à l’identification de cas individuels dépassait les 85 %. Aucun être humain ne pouvait expliquer comment il s’y était pris. À ce stade, les risques de biais et de faux positifs n’avaient aucune importance. Ça fonctionnait. On redoubla d’efforts. Optimisation, intégration, flexibilité, anticipation.
Tout ça, évidemment, je l’ignorais. Ce que je constatai fut que dès le printemps, la gestion de l’épidémie avait radicalement changé d’échelle. Aux mesures de restrictions collectives se substituèrent des myriades de dispositifs de confinement personnalisés : en fonction de son statut – non infecté, potentiellement infecté, infecté –, chaque Français était soumis à une combinaison de restrictions sur mesure. Personne n’avait exactement les mêmes droits et devoirs. Pour les infectés, l’isolement n’était pas négociable – toutes les huit heures, SAFE leur envoyait une demande de selfie, vérifié par reconnaissance faciale et géolocalisation, tandis que le moindre pas à l’extérieur était immédiatement repéré.
Pour les « orange », potentiels infectés au-delà d’un seuil de probabilité de 28 % – une limite définie par la machine, sans qu’on sut jamais réellement pourquoi – les seuls déplacements autorisés étaient ceux entre le domicile et le travail. Des plages horaires spécifiques nous étaient réservées dans les transports publics. Les taxis autonomes ne s’arrêtaient pas pour nous prendre. Magasins, cafés, restaurants nous étaient interdits. Les seuls achats autorisés étaient ceux réalisés en ligne et via des applis de livraison. Être « orange » pouvait durer des semaines, parfois des mois. Puis, un matin, la délivrance – on redevenait « vert », le monde s’ouvrait à nouveau. Sans explication. On ne savait jamais réellement quelle portion de la population vivait sous ce statut de semi-liberté à un instant t, mais les villes en étaient pleines.
D’avril à juillet, les populations des grands centres urbains apprirent à vivre dans ce nouvel espace public fragmenté, aux frontières sans cesse renouvelées. Se retrouver dehors entre amis releva bientôt du cauchemar logistique. Alors on s’adapta, comme on s’était adapté pendant les premiers mois de la première vague. On comprit rapidement, moi le premier, que le réel était un privilège réservé aux « verts ». Les « orange » et les « rouge » passaient leur quarantaine entre apéros Zoom, marathons Netflix, drague Tinder et conversations Whatsapp. On apprit à prendre son mal en patience. A quoi bon sortir si aucune porte ne s’ouvre ? Ça ressemblait à ça, vivre avec le virus.
SAFE faisait le boulot, anticipait, devinait avant tout le monde la probabilité qu’on soit infecté en fonction de son état de santé, de son rapport à l’autorité, de son rythme de travail, de ses convictions politiques, de ses goûts culturels, de son appartenance à telle CSP ou groupe social, et probablement de milliers d’autres variables personnalisées. L’épidémie était sous contrôle, la plupart du temps. On était libres, la plupart du temps. Ça aurait pu être pire.
Il n’y eut pas de cérémonie particulière pour marquer la fin de l’épidémie de Covid-19. Le variant Omega déferla sur le monde à l’été 2023, supplantant tous les autres et réduisant le virus au statut de grippe saisonnière en quelques mois. Un coup de pot planétaire, rien de moins. Il n’y eut pas de retour en arrière non plus. Il n’y en a jamais. Un outil pareil n’avait pas vocation à rentrer gentiment au placard une fois la situation sous contrôle. Les dispositifs nés pendant l’accélération sécuritaire de 2022-2023 restèrent en place.
Les caméras filmaient, les drones bourdonnaient dans les rues, les portiques s’ouvraient docilement pour la majorité des gens. L’état d’exception perdurait, sous un autre lexique. Au cas où. Les comportements se normalisaient. SAFE moulinait encore, quelque part dans les couloirs du ministère. Des données entraient, des cibles sortaient. Suspects de terrorisme, activistes, chômeurs, intellectuels hétérodoxes, opposants politiques, fraudeurs aux allocs, journalistes d’investigation, délinquants et criminels potentiels, malades… Pour la première fois dans l’histoire des gouvernements, l’anormal était sous contrôle. Peu importe la définition qu’on lui donnait. On avait la solution. Ne restait plus aux gouvernants qu’à identifier les problèmes. Qu’à identifier les probables. Les ni tout à fait vert, ni tout à fait rouge encore. Les vous, les moi. À suivre. Au cas où.
Ce matin, dans un demi-sommeil, j’ai cru reconnaître la sonnerie d’alerte Covid de mon téléphone. Un mauvais rêve, terminé depuis près de deux ans.
Sur la table de chevet, mon écran luit patiemment, monochrome.
Orange.
Thibault Prévost
Note (très) importante : J’ai supprimé les liens de ce fantastique article afin de rendre le récit plus « SF » mais l’article original qui a été publié sur le site d’Arrêt sur images le premier Aout 2021 a été écrit en se basant sur des éléments factuels. Il est à lire (et à relire) de toute urgence, et surtout avec ses liens qui mènent aux sources, pour comprendre que nous ne sommes définitivement pas dans une série de Black Mirror, mais bien dans de la pure réalité.
Réaliser que 2025, c’est seulement dans 48 mois.
Don Juan